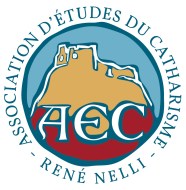Samedi 25 novembre 2017. l’AEC / René Nelli vous invite à assister à deux conférences sur:
La prison de l’inquisition de Carcassonne. Enquête sur un monument oublié.
14 h 30 – 15 h 00. L’évêque Clarin, les Dominicains et la création de l’Inquisition à Carcassonne (1233-1248). Conférence proposée par Charles Peytavie, historien médiéviste, spécialiste du catharisme.
 Ancien chapelain et chancelier de Simon de Montfort, Clarin devient évêque de Carcassonne en 1226. Il s’engage aussitôt dans la réforme des institutions ecclésiastiques de son diocèse et mène un combat obstiné contre les hérétiques (cathares et vaudois). A partir de 1233 et jusqu’à sa mort en 1248, il accompagne la création de l’Inquisition à Carcassonne et facilite l’installation matérielle des inquisiteurs dominicains dans sa cité épiscopale. Retour sur un évêque oublié de Carcassonne dont l’action fut pourtant décisive dans la lutte contre les hérésies méridionales.
Ancien chapelain et chancelier de Simon de Montfort, Clarin devient évêque de Carcassonne en 1226. Il s’engage aussitôt dans la réforme des institutions ecclésiastiques de son diocèse et mène un combat obstiné contre les hérétiques (cathares et vaudois). A partir de 1233 et jusqu’à sa mort en 1248, il accompagne la création de l’Inquisition à Carcassonne et facilite l’installation matérielle des inquisiteurs dominicains dans sa cité épiscopale. Retour sur un évêque oublié de Carcassonne dont l’action fut pourtant décisive dans la lutte contre les hérésies méridionales.

Les vestiges de la prison inquisitoriale de Carcassonne retrouvés par D. Baudreu et F Calvayrac en 2012 au pied de la Cité. Photo D. Baudreu.
15 h 00 – 16 h 30. La redécouverte du « Mur » ou prison de l’Inquisition à Carcassonne. Enquête sur un monument oublié. Conférence proposée par Dominique Baudreu, historien et archéologue au Centre d’archéologie médiévale du Languedoc et Fabienne Calvayrac, guide-conférencière nationale.
Lieu d’incarcération de nombreux hérétiques (parmi lesquels le dernier Bon homme connu, Bélibaste, qui s’en est évadé) ou de leurs partisans, la prison de l’Inquisition de Carcassonne ou Mur, institution à la fois crainte et dénoncée par les habitants du Midi, demeura pendant un temps le symbole de l’action répressive menée par les inquisiteurs. Grande figure de cette contestation au début du XIVe siècle, le franciscain Bernard Délicieux y fut enfermé en décembre 1319 et y mourut quelques mois plus tard.
Identifiée au début du XXe siècle, l’emprise du Mur n’a pas pour autant réellement attiré la curiosité des chercheurs. Mais depuis quelques années, des reconnaissances de terrain confrontées aux données historiques nous permettent de mieux cerner les limites de la prison et d’en caractériser les vestiges. En 2012, Dominique Baudreu et Fabienne Calvayrac ont pu entamer une étude des vestiges encore en élévation. Un sondage archéologique a permis de dégager jusqu’au seuil ce qui fut probablement l’unique porte du Mur, bien différente de celle qu’avait pu imaginer le peintre Jean-Paul Laurens en son temps.



 Publié par aecnelli
Publié par aecnelli 






 Hugues de Lacy (v.1176-1242) , un irlandais seigneur de Castelnaudary et de Laurac.
Hugues de Lacy (v.1176-1242) , un irlandais seigneur de Castelnaudary et de Laurac. L’Association d’études du catharisme / René Nelli a le plaisir de vous convier à sa nouvelle journée découverte, le samedi 10 mars 2012, sur les pas des cathares à Toulouse.
L’Association d’études du catharisme / René Nelli a le plaisir de vous convier à sa nouvelle journée découverte, le samedi 10 mars 2012, sur les pas des cathares à Toulouse.